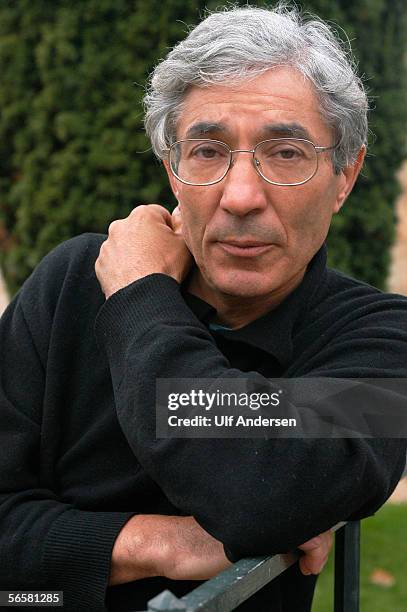Hélé Béji
La patrie perdue de Boualem Sansal
L’écrivain, arrêté à son retour à
Alger le 16 novembre, fait les frais d’un contresens fâcheux. Les
polémiques dérisoires n’ont rien à voir avec son œuvre qui n’appartient ni à
l’Orient ni à l’Occident. Ceux qui en font un héraut de leur fantasme de
« civilisation » ne l’ont pas lu, pas plus que ceux qui l’accusent de
trahison.
Je crois qu’on ferait une grave erreur si l’on défendait Boualem Sansal comme un auteur qui
serait le porte-flambeau de l’Occident « avancé », contre
le monde musulman « arriéré ». C’est un contresens très
fâcheux que font les médias dans leur ensemble, de part et d’autre de la
Méditerranée. Chacun montant sur ses ergots et réarmant « nos » valeurs
contre les « leurs ». Même si Boualem, dans ses
entretiens radiophoniques, se laisse emporter par cette facilité, cette
polémique dérisoire n’a rien à voir avec son œuvre. Celle-ci est bien
au-dessus. La force de son esprit, l’intensité de son écriture, la hauteur de
son regard, cet imaginaire de tendresse qui vous pénètre quand vous le lisez,
est au-delà de toute appartenance culturelle.
Boualem n’écrit ni comme un
Algérien, ni comme un Français, ni comme un arabe, ni comme un musulman, ni
comme un anti-musulman, ni comme un Oriental, ni comme un Occidental. Il écrit
comme un poète dont l’immensité passe toutes les frontières des préjugés, des
hypocrisies, des mensonges. Magie qui transcende la prophétie divine pour la
condition tragique et sensuelle du genre humain, le récit de sa lutte contre
l’épouvante d’être son propre bourreau, la pulsion absurde de s’autodétruire.
La plupart de ses laudateurs ou de ses accusateurs ne
l’ont pas lu, j’en suis persuadée. Ils ont happé ici où là quelques formules
qui les heurtent ou au contraire les ravissent, en les ramenant à leurs
stéréotypes. Et les voilà s’étrillant et tirant les défunts de la guerre
d’Algérie de leurs ossements, en les déterrant, en organisant cette bataille
funèbre de squelettes qui s’empoignent dans la poussière du cimetière de
l’histoire comme des zombies aux orbites noires.
Non, ce n’est pas ça, Boualem Sansal. Boualem écrit la
musique déchirée de ceux que l’histoire a écrasés, que ce soit la tragédie
coloniale ou les dérèglements postcoloniaux. La morale de Boualem est
l’étincelle de la quête du bonheur dans des contrées toujours accablées des
obscurs fantômes des crimes que l’histoire leur a réservés, et de l’impuissance
d’en briser le sort.
La musique de Boualem n’est ni celle de l’Orient, ni
celle de l’Occident. Elle est celle de l’échec humain de l’émancipation que
l’on avait crue si proche pourtant dans l’épopée des peuples décolonisés. Toute
sa prose est ciselée dans cette souffrance dont le thème n’a rien à voir avec
un quelconque slogan idéologique. Chez Boualem, il n’y a aucune défaite ni
victoire des deux acteurs de l’histoire, la France et l’Algérie. Boualem, c’est
quelque sanglot de la vraie patrie où ni l’une ni l’autre ne sont dignes d’être
représentées. La patrie pure et douce d’une Algérie invisible au commun des
mortels, et d’une France où la fibre littéraire se dénature dans le cliché
nationaliste de la « trahison des clercs », comme dirait
Julien Benda.
Il suffit de lire n’importe quel texte de Boualem pour
éprouver au fond de notre gorge cet amour infini pour l’Algérie, qui traverse
sa prose où frémit le passé, le présent, le futur d’une vie, la sienne, dans
une fêlure bouleversante entre son être et son pays natal. Il y a dans cette passion
entre lui et cette terre, un miracle d’inspiration qui l’a toujours empêché de
vivre ailleurs. Il perdrait la source de son génie. Ce sont les personnages de
ce peuple supplicié qui animent la férocité suave de son regard, de ses images,
de ses paysages. Le pacte créateur, le lien entre l’Algérie et lui est si fort
qu’il en tire une grandeur secrète, mêlée de lucidité douce-amère. Quel que
soit le désespoir chez Boualem, un hymne lyrique chuchote les notes d’une
patrie rêvée dans ses heures sombres, sur les cordes pudiques de son esprit
supérieur et enjoué. En le lisant, notre cœur bondit dans le ramage de son
récit épique, acerbe et miséricordieux. Chez lui se mêlent la colère et la
compassion en une chimie unique, miraculeuse, où le pardon humain perce la
croûte inhumaine du châtiment. Sa prose est la caresse cruelle de son regard
sur la vérité d’une société, dont il apparaît comme le plus humble de ses
habitants dépossédés de leur dignité, leur joie, leur créativité. Mais il les
connaît, il décrit leur vitalité et leur amour de soi sous le mépris, étouffé
par des discours qui ne sont d’aucun secours pour la misère quotidienne, mais
au contraire l’entretiennent et l’exploitent. En fait sa puissance littéraire
est faite de cette vénération pour une patrie perdue, abandonnée des siens,
avec un chagrin mêlé du sens de sa beauté profonde et limpide, sans pouvoir en
faire le deuil.
La satire comme bonté
Derrière une atmosphère de massacre, toujours un appel
d’innocence. Derrière la chute, la rédemption. Par-delà les masques de
l’Appareil, comme il l’appelle, le visage inaltéré de l’instinct de bonté des
plus humbles. La satire de Boualem est la forme irrésistible de sa bonté. Et sa
liberté est la révolte de son cœur solidaire des victimes, par-delà l’injustice
des puissants. L’obscurantisme le hante. Mais c’est l’obscurantisme de
l’oppression, quel que soit l’argument qu’elle avance, nationaliste, partisan,
chauvin, religieux, fanatique. Le fanatisme que combat Boualem n’est pas
d’ordre religieux, mais d’ordre politique, quand celui-ci transforme la
croyance en une prison obtuse, celle de la pérennité sauvage de ceux qui ont
fait l’indépendance, pour se l’approprier en totalité, en effaçant les
libérations qu’elle incarnait.
Les romans de Boualem ne sont que l’épopée délicate et
douloureuse de cette conscience humaine qui court sous la foule, sous la
jungle, avec l’élégance agile et souple d’un élan de félin, dont le flair
instinctif est un désir cosmique de vivre et de dire, avec un talent poétique
éblouissant. Ceux qui l’accusent de trahison et d’antipatriotisme n’ont rien
compris, car ils ne l’ont jamais lu. Et ceux qui l’encensent comme un héraut de
leur fantasme de « civilisation » font le pire des
contresens de la civilisation elle-même. Ils ne l’ont pas lu non plus, mais ils
ont juste parcouru quelques-unes de ses déclarations en y piochant ce qui leur
plaisait d’entendre.
Non, Boualem n’est ni de ceux-ci, ni de ceux-là. Son
étoffe est d’une autre nature, l’exquise lumière d’un cœur conscient. Il
n’appartient ni à la thèse, ni à l’antithèse. Son écriture est cette
composition de merveilleux et de sordide qu’on trouve dans les romans russes,
qui rejoint avec une sensibilité meurtrie la condition inférieure de ceux qui
ont été floués en servitude, dans l’ombre d’une histoire criminelle dont
personne n’a encore fait le procès. Il tente avec une vocation romanesque
nonpareille en Afrique du Nord, d’en souligner les difformités, en laissant
toujours échapper sous les grimaces de la froideur, de la laideur, sa fascinante
complicité radieuse avec ceux qui, sans le savoir, dans leur être rustique et
démuni, sont les inspirateurs merveilleux et les dépositaires inconscients de
son génie.
Quand Boualem est arrêté, c’est le cœur pensant et
souffrant de sa patrie, dont la voix tenue, enfantine, claire tinte comme une
flûte enchantée dans ses livres, qui s’arrête tout simplement de battre.